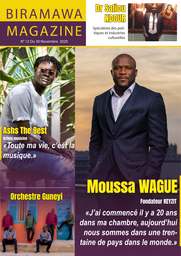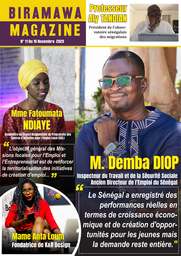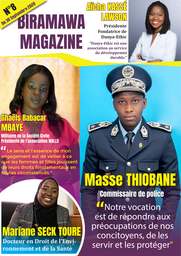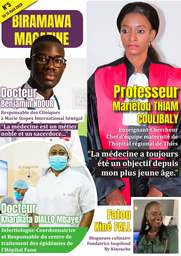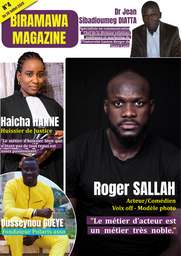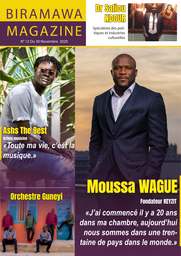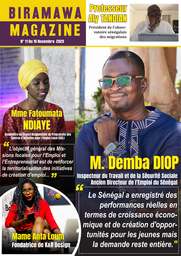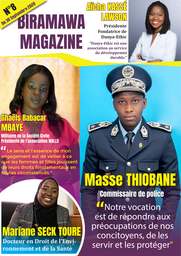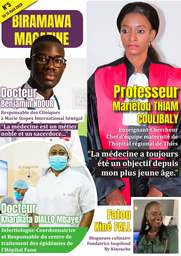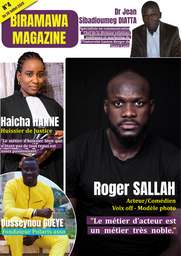mélange d’eau (…) et de sel de potassium. Entre
les deux domaines, l’extra et l’intracellulaire existe
une cloison, enveloppe des cellules, membrane cellulaire,
osmotique.
Perméable à l’eau, elle est imperméable
aux sels et fait nouveau et capital imperméable aux
ions qui composent ces sels. Le liquide interstitiel
contient pratiquement la totalité du chlorure
de sodium de l’organisme. Il est en équilibre osmotique
avec les sels de potassium de la cellule.
Toute modification, gain ou perte, de ce sel extracellulaire,
quelle qu’en soit la cause, détermine un
échange d’eau entre les milieux extracellulaires.
Là, est le devoir d’équilibre »⁹. On peut en déduire
que les Africains par conscience ou par expérience
ingéraient le sel pour la santé.
Les témoignages de Cada Mosto révèlent que les
peuples, plus particulièrement ceux qui vivaient
dans les régions chaudes, doivent en consommer
régulièrement pour l’équilibre humain. Au XVe
siècle, il écrivait : « (…) à quoi emploient ce sel les
marchands de Melli, ils me furent répondus qu’ils
s’en usent en leurs pays quelque quantité, pour autant
que la proximité qu’ils ont avec l’Equinoxial il
y’a de grandes chaleurs en certain temps de l’an, au
moyen de quoi le sang vient à se corrompre et putréfier,
tellement que si ce n’était ce sel, ils en prendraient
la mort. Mais ils y pourvoient par un tel remède
; ils prennent une petite pièce de ce sel qu’ils
détrempent avec un peu d’eau dans une écuelle de
laquelle ils usent et boivent tous les jours, chose
qui les contregarde et guérit. »¹⁰
Au-delà de son rôle physiologique, les consommateurs
recherchaient aussi le goût salé pour rendre
agréables les mets. R Caillé écrivait : « Au chef de
Sancougnan, (…) nous allâmes à la case qu’on nous
avait destinée ; peu après on m’apporte de la part
du mansea (…), une calebasse de riz, de lait et du
beurre fondu le tout saupoudré de sel que nous
mangeâmes à notre dîner. »¹¹ À la fois aliment et
condiment, le sel occupait une place prépondérante
dans la nourriture quotidienne. Les animaux
n’échappent pas à cette logique.
⁹ ibid
¹⁰ DE C’ADAMOSTO Alvares, 1895, Relation des Voyages à la Côte Occidentale d’Afrique, Paris, éd : Ernest Leroux, P. 56.
11 R Caillé op cit, p. 90.
12 BOUTRAIS j., « Cure salées, cures natronées pastoralismes en savane centrafricaines », Journal des africanistes, N° 89-1 , 2019, p. 84115,
P. 2.
1³ MARIKO, K. A., Souvenirs de la boucle du Niger, 1980, Dakar, éd : Les Nouvelles Editions Africaines, P. 90.
1⁴BOUTRAIS J., op cit, p. 3.
46-BIRAMAWA MAGAZINE
La cure salée des animaux, une pratique
thérapeutique des Pasteurs
Dans l’histoire pastorale, la recherche de sel a souvent
conditionné de récurrents mouvements de
transhumance. Autant que l’homme, la vache a besoin
de sel pour remplacer celui qui est éliminé par
la sueur, l’urine et le lait. « Lorsqu’elles ressentent
un déficit en sel (…), les vaches adoptent un comportement
inhabituel dont les éleveurs restituent
les manifestations principales : elles meuglent
continûment. Si l’attente de complément minéral
se prolonge, leur façon de paître change, en devenant
plus discontinue ; elles perdent des forces et
s’amaigrissent. »¹²
Ce besoin impérieux engendrait des déplacements
périodiques des troupeaux vers les prairies salées.
Ce phénomène était observé dans le Nord-Est du
Sahel par le vétérinaire Kélétigui A. Mariko « Après
l’effroyable sécheresse qui décima bête et gens
dans tout le sahel, l’hivernage s’installa dru, régulier.
Partout tout verdoyait. Les bœufs reprenaient
de l’embonpoint, le poil brillant, le mufle sec, l’œil
luisant, ils gambadaient par les vastes plaines en
routes vers les terres salées de l’Azawak. Là-bas, en
plein nord est, vers le Niger où les salines de Taguidda-Tessoum
accueillent chaque année des milliers,
des dizaines ou des centaines de milliers de
têtes de bovins, d’ovins, de caprins de chameaux,
venus là faire la cure salée (…). »¹³
Au-delà de sa dimension physiologique, la cure salée
revêtait une dimension culturelle. Le retour des
troupeaux était l’occasion d’organiser des activités
festives. « Les cures salées ou natronées donnent
lieu à des scènes spectaculaires, par exemple aux
environs d’In-Gall, au Niger. Aux tours des sources
salées se rassemblent, chaque année, de nombreux
Touaregs et Peuls nomades. »¹⁴ Ces cures salées
occupaient une place centrale dans la vie de relation
du monde pastoral. Mariko plaidait pour sa
préservation. « Devrons –nous effacer à tout jamais
de nos vues et de nos souvenirs les spectacles
éclatants de couleurs et de dynamisme que représentaient,
au Macina, comme dans la zone lacustre,
dans l’Azawak, la Tamesna, l’Oudalan, les retours
des transhumances d’immenses troupeaux, indiscutablement
les plus beaux de l’Afrique occidentale
? Devrons-nous oublier pour toujours toutes ces
fêtes bucoliques inséparables des cures salées (…)
qui jadis rassemblent toute la population à des kilomètres
à la ronde ? » ¹⁵
Il semble que la transhumance vers les terroirs salicoles
du Saloum était causée par l’existence de
marais et prairies salés qui bordent la rivière du
même nom. Durant la saison des pluies, les pâturages
salés recouvraient d’une végétation qui attirait
les éleveurs. Un informateur à Ngathie, nous
dit que jusqu’à une période récente, les pasteurs
guidaient leurs troupeaux jusqu’aux marais salants
de Ngathie pour la cure salée. Le toponyme d’un
marais salant « Mbarkha-Khélé » illustre cette pratique
qui était bien observé par Almada. Ce dernier
écrivait au XVIe siècle, « pendant l’hiver, les Foulos
font paître leurs troupeaux sur les côtes habitées
par les Jolofos, les barbacins[seereer] et les Mandingues
et pendant l’été, ils rentrent dans l’intérieur
(…) »¹⁶.
Ainsi, grâce à son rôle thérapeutique, le sel était
l’or du pasteur. Autant que l’eau, le sel rythmait
la dynamique pastorale. La transhumance durant
l’hivernage était nécessaire pour la santé des animaux.
Le
Moundé chez les Peuls du Fouladou
La
présence du sel dans le mythe d’origine de la
vache permet de dire qu’il était en partie à l’origine
du Moundé. « D’après la tradition orale, trois
jeunes vaquaient tranquillement à leurs occupations,
lorsque soudain, une vache ayant des taches
noires, rouges et blanches (mais avec une prédominance
des taches noires), sortit de l’eau pour se
diriger vers la berge. Aussitôt, l’un des jeunes gens
se mit à la pourchasser pour essayer de l’attraper,
mais il n’y réussit pas. Le second en fit de même ; il
échoua à son tour. Le troisième jeune gens s’avança,
s’approcha tout doucement et dit : « Hurr, hurr !
Vient ma belle à la robe magnifique ! Arrête-toi ma
douce ; viens par ici ! À leur grand étonnement, la
vache ne fit pas un pas de plus. Elle s’arrêta net et il
s’en saisit ; ce jeune homme –là était un Peul ! Or ce
Peul n’avait pas omis de noter que, lorsque la vache
était sortie de l’eau, elle s’était dirigée vers un endroit
précis de la berge. C’est pourquoi il s’y rendit
aussi et constata que l’endroit était fortement salé.
Le Peul conclut alors que pour domestiquer la
vache, il faudrait lui donner régulièrement du sel.
Mais, étant donné que l’animal qui avait été conduit
au village était un bovidé-femelle, le Peul décida de
retourner au bord du fleuve pour y chercher un bovidé-mâle.
Et c’est là qu’on dit qu’il a rencontré le
Génie de l’eau, le Gardien des vaches et des troupeaux.
(…) Le Génie lui fixa un rendez-vous sans
que rien ne se passe. Au troisième rendez-vous, le
génie lui recommanda de faire le moundé. »¹⁷
D’après les témoignages
recueillis au Fouladou
par Moustapha BARRY, « la recherche de ce sel a
conduit des Peuls -Fouta à s’installer définitivement
dans la province Firdou du Kabou. »¹⁸ Le
terroir était la première zone de diffusion de sel
marin produit en Casamance et dans les rivières du
sud. « En Mandingue le Firdou est l’endroit où on
exerce le commerce (Firo= commerce ; dou= géographie).
»¹⁹ Sa proximité avec les zones de production
permettait aux éleveurs de se ravitailler
moins cher pour la cure salée.
La préparation du rite chez les Peuls du Fouladou
montre que sans le sel il est impossible d’organiser
la fête des vaches. En effet, « les feuilles, les racines,
les écorces et les fleurs de palmier sont pilées et
malaxées avec du sel »²⁰. Amadou Ndiaye pense
qu’« il faut chercher le sens profond du moundé
dans la quête effrénée du grand nombre de vaches.
En effet, l’idée la mieux partagée chez les Peuls, est
que la vache qui est arrivée la première, lors de la
course, donne successivement naissance à neuf
veaux femelles avant de mettre bas un veau mâle.
»²¹
1⁵ MARIKO, K. A., op cit, p. 90.
1⁶ Almada A. A., op cit.;P.73
¹⁷ Ndiaye A., La fête de la vache chez les Peuls du Fouladou ou la perpétuation du rite du sel, Annales de la Faculté des lettres et Sciences
Humaines, n°39/B 2009, P.226.
1⁸ Ibidem
1⁹BARRY M., « L’implantation des Peuls du Futa djallon dans le Fuladou » (1867-1958), 2000-2001, UCAD, Dpt Histoire, Mémoire de
Maîtrise, P. 18.
2⁰BARRY M., op cit, p.9.
²² Massamba TALL, Immam de la grande mosquée de Ndiobène Tallène.
BIRAMAWA MAGAZINE - 47